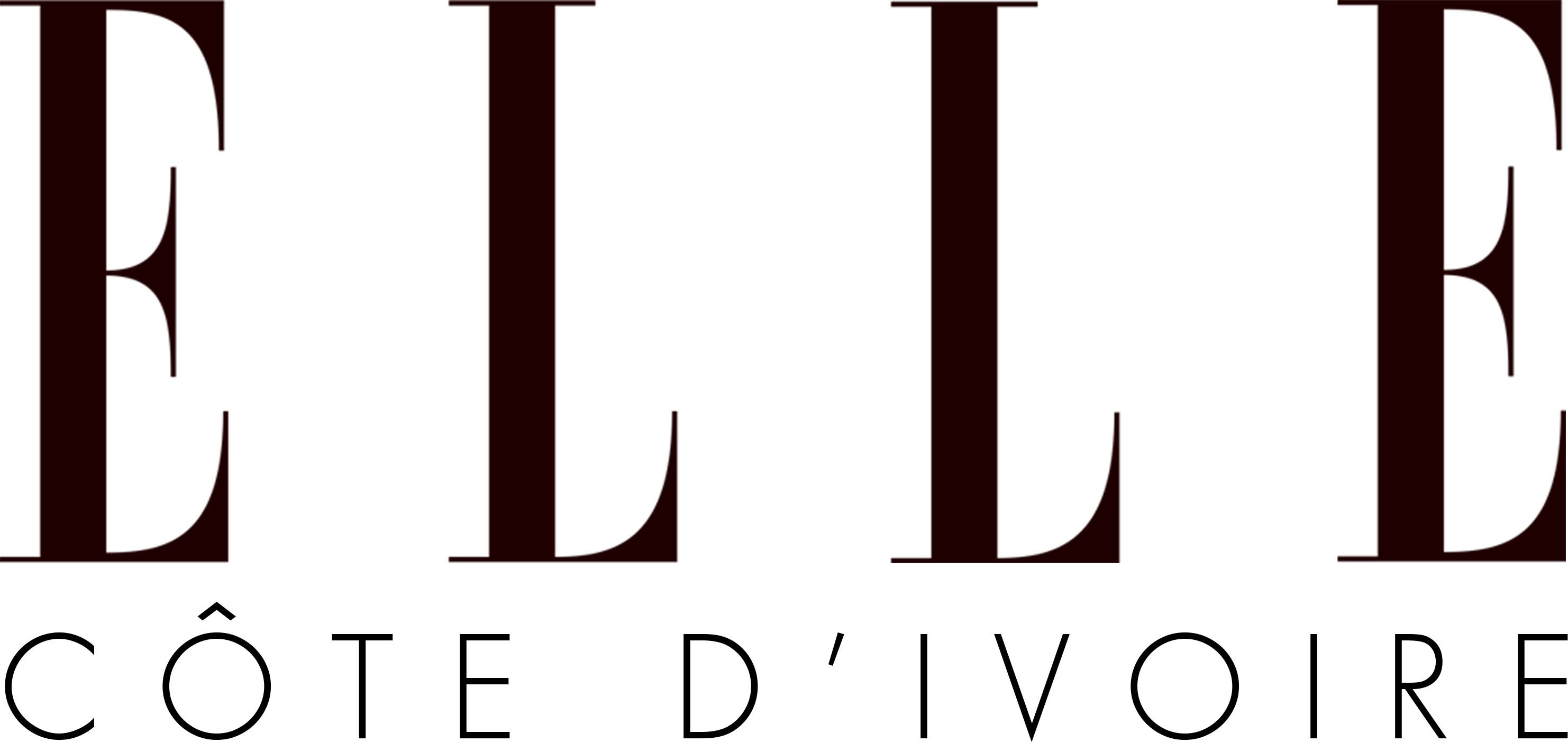“La faim fait de tout homme un voleur”
Kostadis J. Papaioannou
Au Sénégal, l’histoire des prisons remonte à l’époque coloniale, avec l’implantation des premiers établissements pénitentiaires à Gorée et Saint-Louis. À l’origine, ces prisons servaient à enfermer ceux que le pouvoir colonial considérait comme une menace : les mendiants et les vagabonds.
La criminalisation féminine a émergé à cette période, notamment à partir des années 1925-1930, lors de la crise de l’arachide. Confrontées à l’effondrement économique de leur milieu rural, de nombreuses femmes ont migré vers les villes en quête de meilleures conditions de vie. Mais dans ces nouveaux environnements, elles se sont souvent retrouvées dans une extrême précarité. Prises au piège d’un système qui criminalise leur survie. L’avortement et l’infanticide sont ainsi devenus des actes désespérés, motivés par la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d’un enfant dans la misère.
Aujourd’hui encore, la pauvreté reste l’un des principaux moteurs de l’incarcération des femmes. Des études récentes montrent que la majorité des détenues proviennent de milieux défavorisés. Lieu dans lesquels les violences économiques, sociales et sexuelles sont omniprésentes. L’infanticide et l’avortement figurent parmi les principales causes d’incarcération féminine. Conséquence directe d’un système qui prive les femmes de choix en matière de santé reproductive.
Lire aussi : Femmes en prison, coupables d’être vulnérables.
Le code pénal sénégalais punit l’infanticide et l’avortement clandestin de peines allant de cinq à dix ans de prison. Une sanction d’autant plus sévère qu’elle frappe des femmes déjà en situation de détresse extrême. Et une fois incarcérées, elles doivent affronter des conditions de détention particulièrement difficiles. Héritées de l’époque coloniale, les prisons sénégalaises ont rarement été réhabilitées. Selon l’ONG Tostan, qui mène un projet d’amélioration des conditions de vie des détenues, les cellules sont surpeuplées, accueillant souvent 25 à 30 femmes dans un espace exigu.
À cela s’ajoute une réalité encore plus alarmante : des enfants naissent et grandissent en prison. Ils sont exposés à des conditions précaires jusqu’à l’âge de deux ans, moment où ils sont retirés à leur mère pour être placés. Par ailleurs, l’accès aux installations sanitaires, aux produits d’hygiène et à une alimentation adéquate demeure largement insuffisant. De nombreuses femmes passent des années en détention provisoire, attendant un jugement qui tarde à venir. Ce qui alimente une incertitude qui aggrave leur détresse mentale et physique.

Briser le cycle de la criminalité féminine
Aujourd’hui, nous maintenons l’idée que les prisons sont censées réhabiliter les individus pour les rendre aptes à réintégrer la société. Cependant, les conditions de détention restent déshumanisantes, exacerbant la précarité et la vulnérabilité des prisonnières de manière intergénérationnelle. Apprendre à devenir « meilleur » dans un environnement punitif n’a jamais servi à personne. Au Sénégal, comme dans le reste du monde, le problème ne réside pas seulement dans le fait que la majorité des détenues commettent des crimes pour se sortir de la pauvreté. Il réside aussi dans l’absence de lois et de processus permettant de protéger les personnes les plus vulnérables de la société.
Si la pauvreté induit le crime, il est crucial d’envisager des solutions plus humaines et préventives. Intégrer une approche qui favorise l’accès à la contraception et à des services d’avortement sécurisés. Ceci est essentiel pour réduire le taux d’infanticide, la mortalité maternelle et, par conséquent, l’incarcération féminine.
Il est crucial de commencer à humaniser le récit des femmes confrontées à la décision d’avorter. Voir ces femmes non pas comme des criminelles, mais comme des survivantes d’une société qui les ont dépourvues de choix. Il peut s’agir de situations de viol, d’inceste, de grossesses non désirées dans des environnements de précarité extrême. Parfois mêmes, ce sont des femmes qui ne disposent d’aucun autre choix face à des conditions de vie insoutenables. Plutôt que de les criminaliser ou de les marginaliser, il est crucial de les soutenir. De sorte à leur permettre d’avoir accès à des informations et des services qui peuvent les aider.
Il est impératif de reconnaître la complexité des situations vécues par ces femmes et de leur offrir la possibilité de choisir, non pas en fonction de contraintes sociales ou économiques, mais en fonction de leurs propres aspirations, de leurs droits et de leur bien-être. Une telle approche permettrait non seulement de réduire l’incarcération pour infanticide, mais aussi de préserver la santé physique et mentale des femmes, en les libérant d’un système pénal qui les rend encore plus vulnérables.

Si les États investissent dans des infrastructures sociales plus adaptées, un système éducatif inclusif, des opportunités économiques accessibles, des services de santé sécurisés, des programmes de santé mentale, et offraient aux femmes les libertés nécessaires pour exercer pleinement leurs droits en matière de santé reproductive, nous pourrions véritablement contribuer à la réduction de l’incarcération. En protégeant les plus vulnérables plutôt que de les punir, nous serions en mesure de traiter les causes profondes de la criminalité et de réduire la pression sur un système pénal déjà surchargé.
En imaginant un système où les prisons se videraient non pas par un miracle, mais par des politiques qui répondent aux besoins fondamentaux de la population, nous pourrions commencer à éradiquer les racines mêmes de la criminalité féminine.
« Notre culture n’encourage pas les personnes qui causent du tort à prendre leurs responsabilités. Nous avons un modèle où la personne qui cause du tort est, elle aussi, réellement la victime et survivante. » — Mariame Kaba
ELLE Collective est une communauté vibrante et engagée pour les passionnées de mode, beauté et culture en Afrique et diaspora. Rejoignez-nous pour accéder à des contenus exclusifs, des événements privés, des conseils inspirants de nos rédactrices, contributeurs et experts, ainsi que des rencontres avec des créateurs et visionnaires qui façonnent notre continent. Devenez membre dès aujourd’hui ICI et ayez une voix dans ce projet.