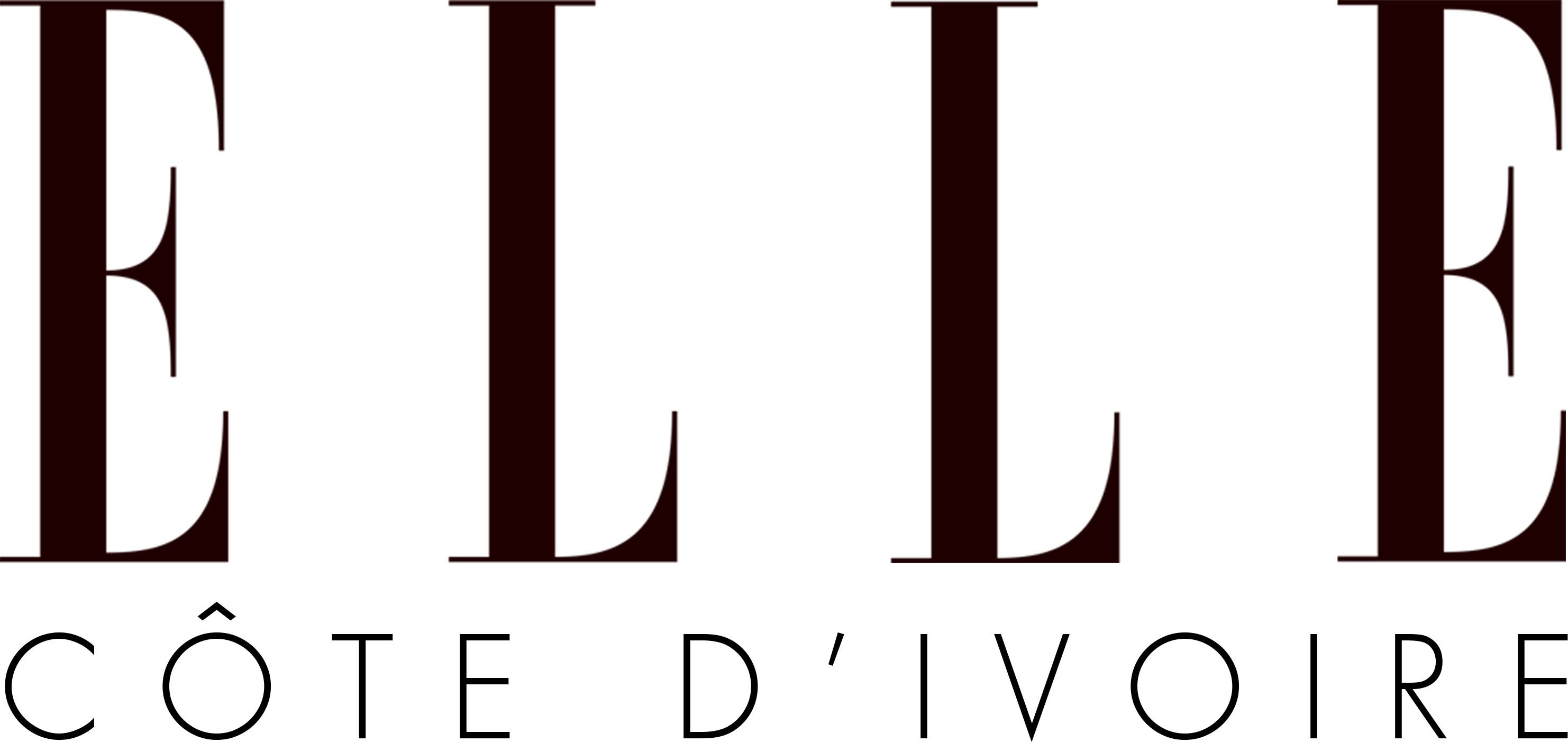La prison est un univers clos et méconnu, un monde que seuls ceux qui y vivent peuvent réellement comprendre.
Pour le reste de la société, sa perception est souvent façonnée par les médias, qui la dépeignent comme un environnement sombre et oppressant. Pourtant, pour les femmes incarcérées, la réalité est bien plus complexe. Leurs motifs d’incarcération et leurs conditions de détention reflètent des inégalités profondes. Les structures carcérales n’étant que rarement adaptées à leurs besoins spécifiques en tant que femmes.
Les causes de l’incarcération
Lorsqu’on pense aux personnes incarcérées, on imagine souvent qu’elles ont toutes commis des crimes graves. Mais si toutes les infractions n’avaient pas la même cause ? Et si, parfois, c’était plutôt l’absence d’options qui poussait une personne à enfreindre la loi ? C’est une réalité pour de nombreuses femmes en Afrique subsaharienne, où le fait de ne pas vouloir mener une grossesse à terme peut mener en prison. Les raisons pour lesquelles une femme peut ne pas être en mesure d’avoir un enfant sont multiples :
- malformation du fœtus,
- grossesse mettant sa santé en danger,
- viol,
- inceste,
- âge trop jeune (encore scolarisée),
- absence de moyens financiers pour offrir une vie digne à l’enfant, ou encore
- abandon par le père ou la famille.
Pourtant, malgré ces contextes complexes, la loi continue de tenir les femmes seules responsables de la vie d’un enfant. Par exemple, en Côte d’Ivoire, la reconnaissance de paternité est un acte volontaire. La législation n’impose pas aux pères biologiques l’obligation de reconnaître leurs enfants. Ce qui laisse la femme seule face aux conséquences d’une grossesse non désirée. Lorsqu’elles tentent d’interrompre leur grossesse dans des conditions précaires et non sécurisées, elles risquent des poursuites judiciaires et l’emprisonnement. Au Sénégal, des données de 2021 révèlent que 25 % des femmes détenues étaient incarcérées pour avortement, 22,13 % pour infanticide et 2 % pour avortement clandestin.
On entend souvent l’argument selon lequel l’avortement serait une pratique occidentale importée. Pourtant, il a toujours existé à travers l’histoire de l’humanité, sous diverses formes : usage de plantes abortives, pressions abdominales, curetage artisanal. Avec l’évolution des sociétés, ces pratiques se sont médicalisées et sécurisées. Mais malgré les avancées médicales et les engagements internationaux, l’accès à l’avortement sécurisé reste limité.
En effet, bien que la majorité des États africains aient signé le Protocole de Maputo, qui autorise l’accès à l’avortement sécurisé en cas de viol, d’inceste ou de danger pour la santé de la femme, peu de pays l’ont véritablement appliqué. L’avortement clandestin demeure une réalité répandue, souvent pratiqué dans des conditions précaires qui mettent la vie des femmes en danger. Une étude de 2018 a estimé qu’entre 4 % et 5 % des femmes en âge de procréer avaient eu un avortement au cours des 12 mois précédents, soit entre 210 000 et 288 000 avortements annuels.
Lire aussi : 16 Jours d’Activisme : Un cri mondial pour mettre fin aux violences faites aux femmes.
Dans plusieurs pays d’Afrique francophone, l’avortement reste interdit et lourdement sanctionné, tant pour les femmes que pour les prestataires de soins. Ce cadre légal restrictif n’empêche pas les avortements de se produire, mais il les rend plus dangereux, exposant des milliers de femmes à des complications médicales et à des poursuites judiciaires, simplement pour avoir voulu exercer un choix sur leur propre corps.
ELLE Collective est une communauté vibrante et engagée pour les passionnées de mode, beauté et culture en Afrique et diaspora. Rejoignez-nous pour accéder à des contenus exclusifs, des événements privés, des conseils inspirants de nos rédactrices, contributeurs et experts, ainsi que des rencontres avec des créateurs et visionnaires qui façonnent notre continent. Devenez membre dès aujourd’hui ICI et ayez une voix dans ce projet.