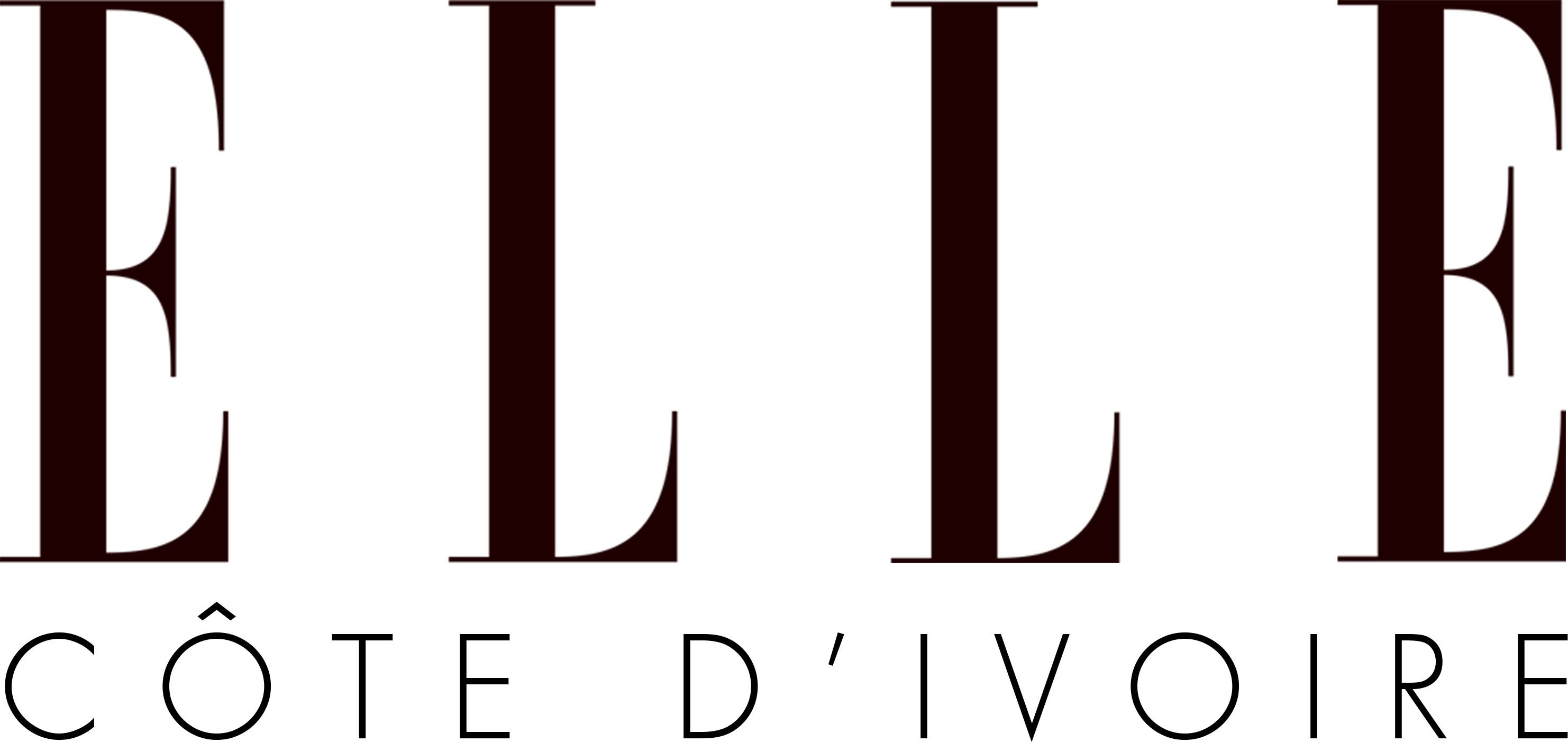Si l’Afrique, et notamment la Côte d’Ivoire, a connu des avancées significatives en matière de droits des femmes ces dernières années, la route vers une égalité effective reste semée d’embûches. Entre réformes législatives, montée en puissance des voix féminines et obstacles socioculturels persistants, quel bilan dresser aujourd’hui ?
En matière d’égalité des genres, la Côte d’Ivoire s’est distinguée en 2023 en étant classée meilleure performeuse africaine dans la lutte contre les discriminations de genre. Un classement basé sur l’indicateur « Institutions sociales et égalité des genres » de l’OCDE, qui salue notamment les réformes légales adoptées par le pays pour protéger les droits des femmes et garantir leur participation active dans la société.
Parmi ces avancées, la modification du Code du mariage en 2019, qui consacre désormais l’égalité des époux dans la gestion du foyer, ainsi que des mesures renforçant l’accès des femmes à la propriété foncière et à l’éducation.
En parallèle, la participation des femmes aux sphères décisionnelles progresse. En juillet 2023, Florence Loan-Messan est devenue la première femme élue bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Côte d’Ivoire, une institution créée en 1959. Une victoire symbolique qui illustre l’émergence d’un leadership féminin de plus en plus assumé.
Sur le terrain, des initiatives comme le Projet d’autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel (SWEDD) ont permis d’améliorer l’accès des jeunes filles aux services de santé reproductive et de promouvoir leur émancipation économique.
Mais derrière ces avancées, les défis restent nombreux. Les violences basées sur le genre demeurent une problématique majeure. En décembre 2024, près de 200 femmes et jeunes filles ont manifesté à Grand-Bassam pour dénoncer les féminicides et les violences dont elles sont victimes, appelant à une application plus stricte des lois et à une sensibilisation accrue de la société.
À l’échelle du continent, plusieurs initiatives majeures ont marqué ces dernières années. Le Protocole de Maputo, adopté en 2003 par l’Union africaine, constitue un cadre de référence en matière de droits des femmes. Il engage les États signataires à garantir leur participation politique, leur accès à la justice et à mettre fin aux mutilations génitales féminines. En 2020, 42 pays africains avaient ratifié ce protocole, bien que son application demeure encore inégale.
Sur le plan symbolique, la Journée internationale de la femme africaine, célébrée chaque 31 juillet depuis 1974, continue de mettre en lumière les avancées et les défis du continent. Elle a contribué à l’adoption de plusieurs instruments de protection des droits des femmes par l’Union africaine.
Dans le domaine du financement et du soutien aux initiatives féminines, des structures comme le Fonds de développement des femmes africaines (AWDF), fondé en 2001, ont permis de financer des centaines de projets. Entre 2001 et 2016, l’AWDF a distribué 26 millions de dollars à des organisations locales engagées dans la lutte pour l’égalité.
Malgré ces progrès, l’application des lois reste un défi majeur. En Algérie, par exemple, malgré des amendements législatifs pour protéger les femmes contre les violences conjugales, les féminicides ne cessent d’augmenter. Depuis janvier 2024, 38 meurtres de femmes ont été recensés, entraînant des mobilisations massives pour dénoncer le manque d’actions concrètes de l’État.
Autre point d’achoppement : la représentation politique des femmes en Afrique. Si certains pays, comme le Ghana, ont adopté des mesures de discrimination positive pour atteindre la parité dans la fonction publique d’ici 2030, les obstacles structurels et culturels freinent encore cette dynamique. Les partis politiques ne sont pas obligés d’intégrer un quota de femmes candidates, et les stéréotypes de genre restent tenaces dans de nombreuses sociétés.
Le bilan des droits des femmes en Côte d’Ivoire et en Afrique est donc contrasté : les avancées sont bien réelles, mais les résistances demeurent fortes. Pour transformer ces acquis législatifs en réalités tangibles, il est crucial de renforcer l’application des lois, intensifier la sensibilisation et promouvoir une culture de l’égalité dès le plus jeune âge.
La lutte pour les droits des femmes ne peut être perçue comme une bataille isolée, mais bien comme une nécessité collective impliquant les gouvernements, la société civile, les entreprises et les citoyens. L’Afrique de demain sera celle de l’égalité, ou ne sera pas.
>> Lire aussi 8 mars 2025 : Lettre ouverte à toutes les femmes et à tous les hommes qui les aiment
ELLE Collective est une communauté vibrante et engagée pour les passionnées de mode, beauté et culture en Afrique et diaspora. Rejoignez-nous pour accéder à des contenus exclusifs, des événements privés, des conseils inspirants de nos rédactrices, contributeurs et experts, ainsi que des rencontres avec des créateurs et visionnaires qui façonnent notre continent. Devenez membre dès aujourd’hui ICI et ayez une voix dans ce projet.