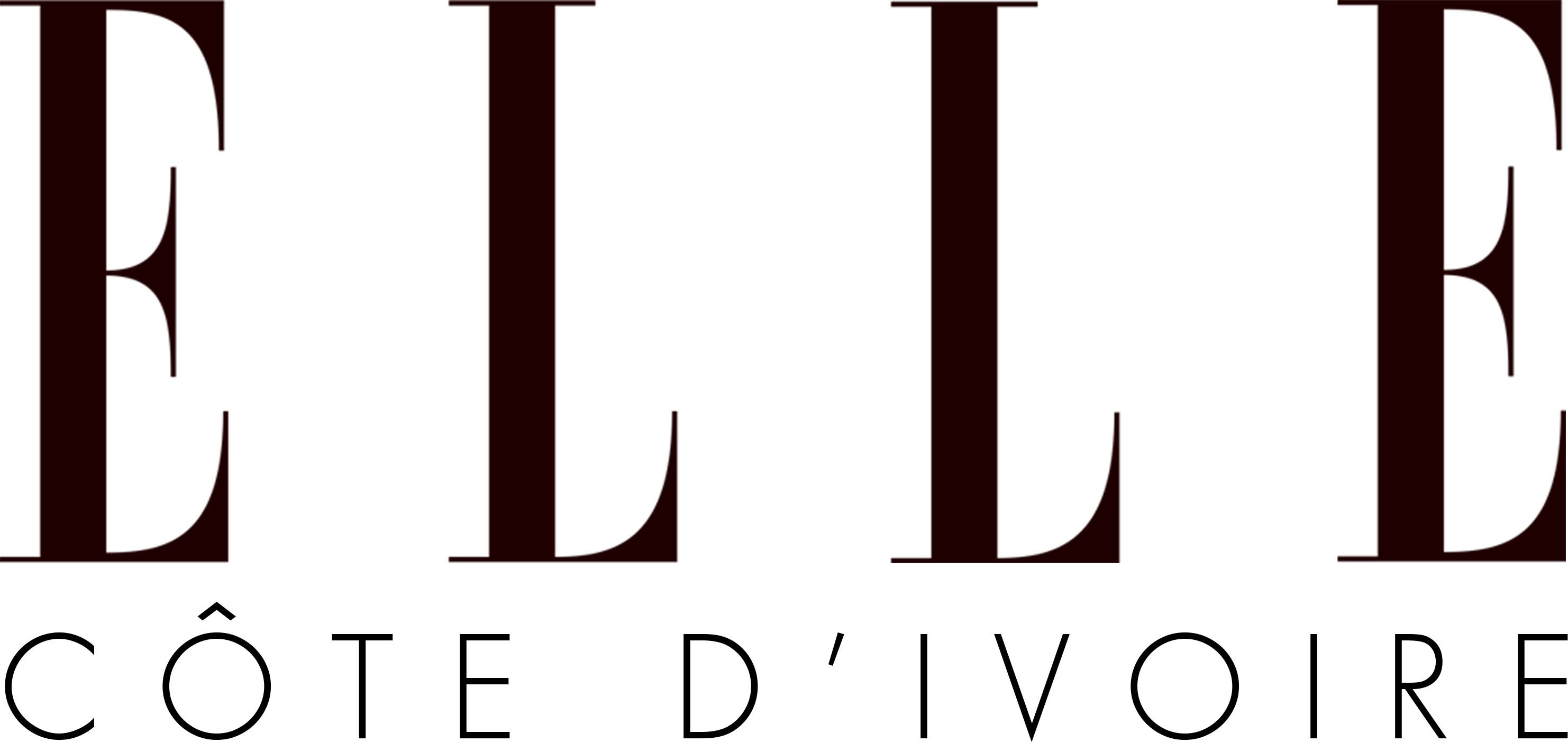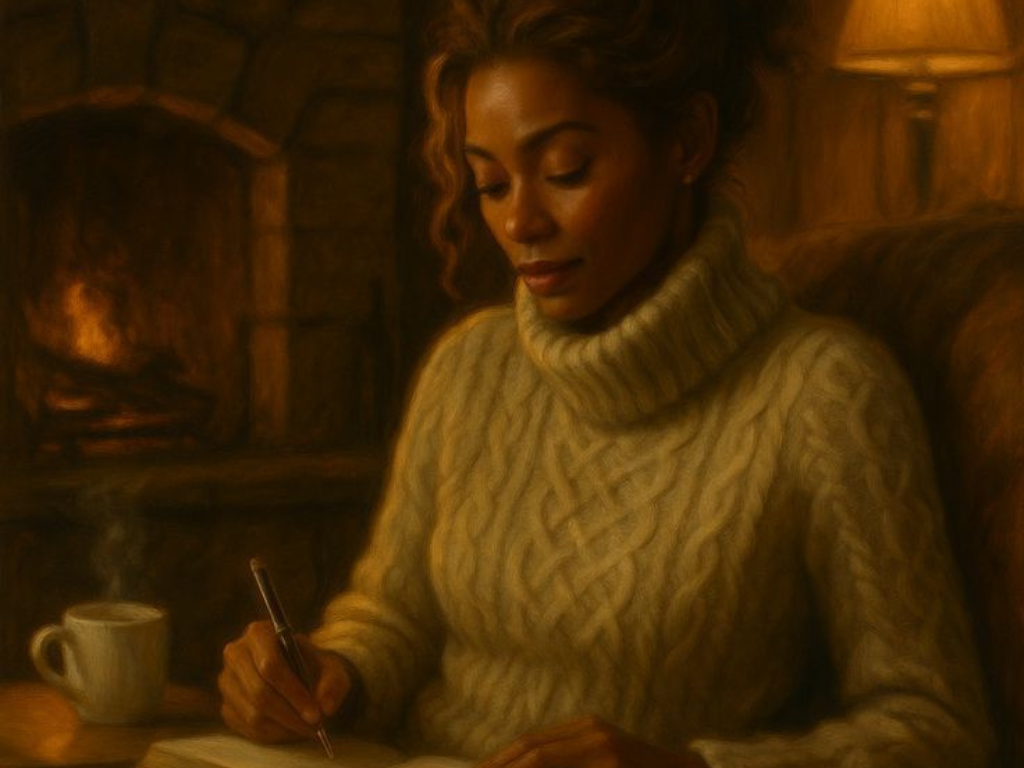Au Ghana, une élève s’est vue refuser l’accès à son lycée pour une raison aussi banale que symbolique : ses cheveux.
L’établissement exigeait qu’elle les coupe courts, au nom de la discipline et de l’égalité.
Mais cette injonction capillaire soulève une question essentielle : jusqu’où peut-on uniformiser sans effacer ?
Dans de nombreux pays africains, la coupe courte reste un passage obligé pour les jeunes filles scolarisées. Héritage colonial ou simple volonté d’ordre ?
Les arguments invoqués, hygiène, sobriété, cohésion, paraissent rationnels. Pourtant, derrière cette apparente neutralité se cache un paradoxe : imposer l’uniformité au nom de l’égalité, c’est parfois nier la liberté d’exister dans sa singularité.
Les cheveux des femmes noires sont bien plus qu’un accessoire.
Ils racontent une histoire, une identité, une mémoire. Ils sont l’un des rares espaces où l’intime rencontre le politique. Les tresser, les protéger, les porter fièrement, c’est affirmer un héritage. C’est dire : je suis ici, entière, ancrée, vivante.
Alors quand l’école, lieu censé émanciper, devient un espace qui contraint le corps, la question devient urgente : quelle idée de la citoyenneté transmet-on à nos filles ?
L’ordre, sans doute. Mais à quel prix ?
Au-delà de la coupe, c’est tout un modèle éducatif qu’il faut réinterroger.
Celui qui confond discipline et obéissance.
Celui qui croit former des esprits critiques tout en exigeant des apparences dociles.
Celui qui célèbre la liberté… à condition qu’elle entre dans le moule.
Et si la véritable égalité commençait par le droit d’être soi y compris dans sa chevelure ?
Car une société qui apprend à ses filles à se taire jusque dans leurs boucles aura du mal à écouter leurs idées quand elles prendront la parole.
Réfléchir à l’uniforme, c’est donc repenser la liberté.
La liberté de penser, de choisir, de créer.
Et, peut-être, de laisser les cheveux parler pour nous.